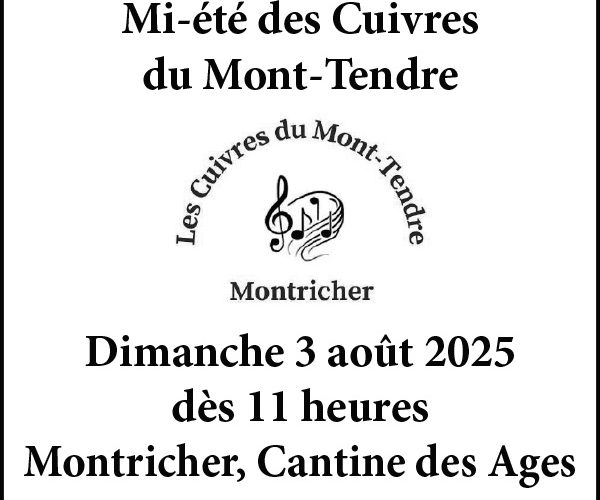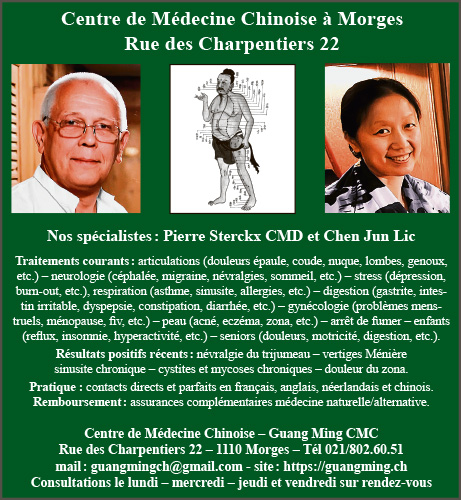Le monde à ma porte – 16 avril 2021

L’autre jour, je regardais par la fenêtre l’hiver qui revenait pour balayer à grandes brassées de flocons les fleurs du cerisier et les pâquerettes de la pelouse. Ah, vaillantes pâquerettes qu’aucune saison n’éteint, qui savent ressortir au premier rayon de soleil pour pointiller le sol de leur bonne humeur toute fraîche. Et qui tiennent bon sous les gelées tardives, se contentant d’être ce qu’elles sont, de simples petites personnes toutes coquettes mais banales qui veulent juste vivre leur vie sans faire de bruit, sans demander ni soins ni affection particulière.
Je les perçois un peu comme les ambassadrices modestes et sincères de tous ces gens qu’on ne voit pas, qu’on ne connaît pas, qui existent bel et bien, qui sont d’ici et d’ailleurs, dont on entend parler chaque jour sous forme de chiffres. Tant de malades ici, tant de morts là-bas, et des courbes, et des statistiques, et des gens anonymes, nos parents de lutte contre la pandémie, sans prénom ni nom, qui ne servent plus que d’indicateurs pour l’avancée ou le recul du virus devenu notre voisin malfaisant. Braves pâquerettes, comme invincibles, que même les robots, sombres envahisseurs qui tondent de plus en plus de pelouses ne parviennent pas à sabrer, tout juste à faire plier.
Je regardais aussi les tulipes, fleurs de Morges par excellence, qui avaient cru le printemps arrivé et avaient jailli en petit groupe du sol encore frais. Elles étaient là, surprises par la neige, transformées en sorbets à l’orange. En naviguant dans mes pensées, j’ai revu des images de Fanfan la Tulipe, un de ces films de cape et d’épée qui animaient l’enfance au temps de la télévision naissante. Du coup, j’ai cherché dans un vieux dictionnaire le sens de tulipe donné à un soldat. En fait, on qualifiait ainsi les sergents et les caporaux de jadis qui faisaient volontiers les jolis cœurs. De pâquerette en tulipe, de fleur en fleur, je ne sais pas pourquoi, mon esprit est parti du côté de Sète, où un jour des années huitante, j’étais allé déposer une rose sur la tombe de Georges Brassens. Si j’y allais maintenant, je le fleurirais de tulipes pour lui souhaiter, en quelque sorte, un bon anniversaire dans l’au-delà.
Quarante ans qu’il est mort. Octobre 1981. Il aurait cent ans cette année et ses chansons, pour notre bonheur, sont comme des fleurs qui résistent à l’hiver et à la neige, au gel et aux tempêtes.
Le jour de son décès, je suis passé de la jeunesse à l’âge adulte en seulement quelques secondes. J’avais vingt-neuf ans, je marchais dans la rue principale d’une jolie ville française. Au fil de mes pas, j’avais entendu et entendu encore et encore, la voix de Brassens qui s’échappait des magasins dont la porte était grande ouverte. Du Brassens partout. Bizarre. J’ai posé la question à une kiosquière, et j’ai compris. Soudain, je me suis senti seul sur le trottoir pourtant plein de monde. Combien de passants, ce jour-là, et les jours suivants, ont-ils porté cette solitude qui naissait dans leur poitrine?
En balade, une fois la neige fondue, et au mépris de la bise, je suis allé saluer devant un immeuble une troupe de pâquerettes bien vives qui semblaient regarder passer les gens en commentant leur allure. Petites bavardes de ras du sol. Petites complices du passant qui sait les voir. À côté d’elles, sur le gazon, il y avait une paire de baskets abandonnées qui étaient déjà là trois jours avant. Oubliées. Deux pieds étaient partis sans elles. Brassens en aurait peut-être fait une chanson, de ces orphelines au pays des pâquerettes.
À lire également...

Bienvenue à Morges-les-Bains

Le football amateur toujours privé de compétition

Le monde à ma porte - 9 avril 2021
Il était une fois, un 16 avril...

Abonnez-vous !
Afin d'avoir accès à l'actualité de votre région au quotidien, souscrivez un abonnement au Journal de Morges. S'abonner, c'est soutenir une presse de qualité et indépendante.
 16
16