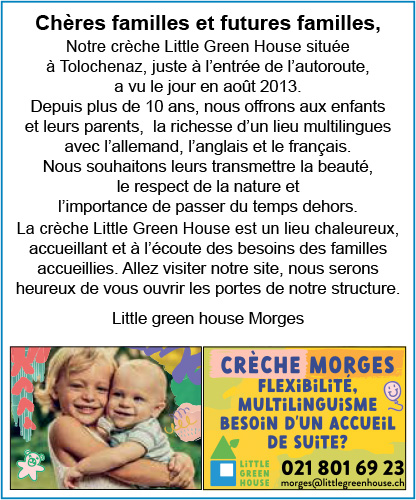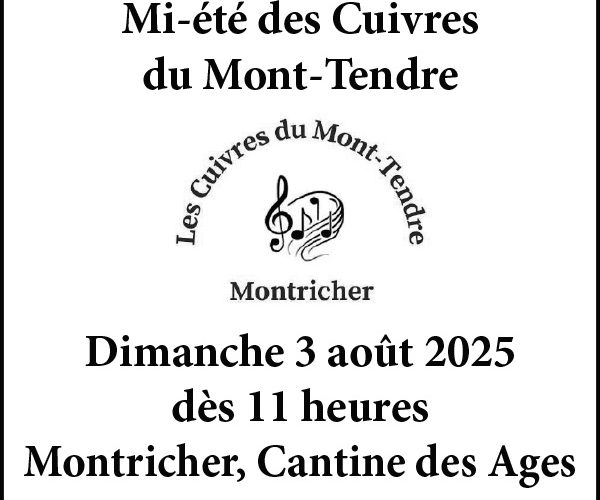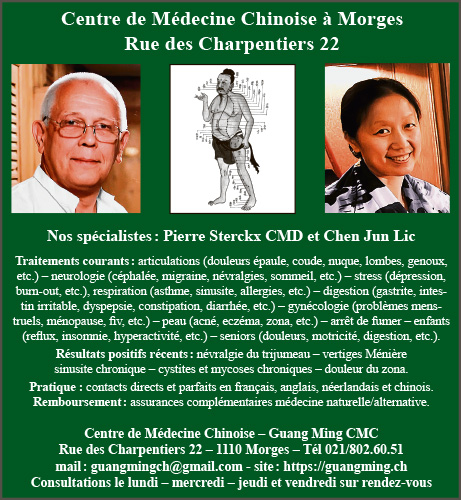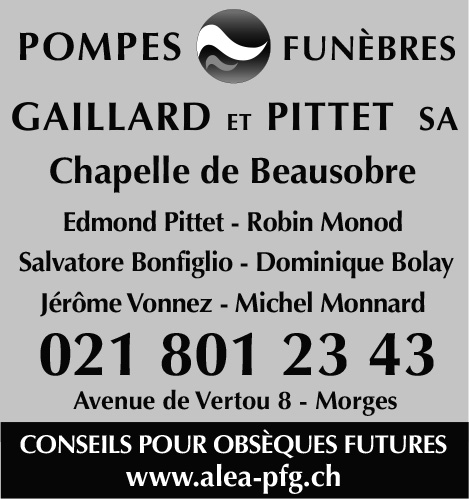La face cachée des symboles de Morges

Les guérites gardent fièrement le port depuis plus de 300 ans. Photo: Nicolet
Elles gardent le port et font partie de l’image de Morges. Les guérites sont bien connues des habitants de la région, mais à quoi servent-elles et depuis quand?
Elles sont un vrai symbole de la Coquette: les deux guérites qui gardent le port sont souvent utilisées sur les cartes postales. Elles figuraient même sur le «stempel» postal morgien dans les années 90-2000. Certains Morgiens ont même des souvenirs de rendez-vous amoureux derrière les deux petites cabanes, et ce malgré les nombreux moucherons qu’on y trouve.
Mais bien avant de devenir l’image de la ville, ces deux guérites ont eu une fonction essentielle.
Dès le XVIIe siècle
De l’ancien français «garrette», dérivé de garir, guarir («protéger, garantir»), une guérite est un «abri pour un homme debout et servant aux factionnaires en cas d’intempéries», nous apprend le Larousse.
Concernant les capites morgiennes, il n’y en avait qu’une seule à l’origine, comme nous le raconte Jules Béraneck dans son article «Le port de Morges: sa fondation et son histoire» paru dans la Revue historique vaudoise en 1939. «Dès le début du XVIIe siècle, la ville avait pris rang parmi les localités les plus importantes au point de vue commercial, en train même de déposséder Villeneuve de sa couronne séculaire, écrit-il. La protection des bateaux, côté vent, ne reposait que sur un petit môle, flanqué d’une guérite de surveillance; côté bise, sur une estacade maintenue par des flotteurs.»
Il est donc acté, plan à l’appui, que dans les années 1670, une guérite était déjà présente – reliée au quai près du château – côté Genève, ville que les marins mettaient 8 heures à rejoindre, toujours selon les écrits de Jules Béraneck. Or, quelques années plus tard, Leurs Excellences de Berne cherchent un port où ranger leurs galères et galiotes. Un groupe d’ingénieurs et de navigateurs fut nommé pour sonder quel lieu serait le plus à même d’accueillir les vaisseaux de Leurs Excellences. Morges fut l’heureuse élue grâce à sa situation géographique «exceptionnelle», car «un vrai carrefour des routes de France, de Bourgogne et d’Allemagne», souligne Jules Béraneck.
Après toute une série de problèmes administratifs et financiers, le port de Morges vit enfin le jour en 1696. Les digues d’origines furent construites grâce à des pals (ndlr: pieux de chêne) de la forêt d’Apples et des pierres d’une partie de la muraille de Saint-Prex, devenue caduque.
Deux nouvelles guérites voient alors le jour. «L’une servait de corps de garde; l’autre, côté bise, de remise pour les chaînes qu’on tendait à la nuit tombante», détaille l’auteur morgien.
Cantonales
Curieuse de savoir s’il reste quelques traces de cette époque, je me suis rendue auprès du garde-port. «Les guérites appartiennent au Canton, m’explique Gérard Humbert Droz. J’ai la clé, mais on n’y va jamais. Il y a juste le tableau électrique qui nous permet de gérer les lumières rouge et verte de l’entrée du port.» Tout en discutant, il ouvre la porte de l’une d’elles en souriant: «J’espère que vous n’avez pas peur des araignées». En effet, la cahute de 6 m2 – selon le cadastre cantonal – ne regorge pas de trésors, mais juste de deux bancs en bois, d’une bouée et même… d’une bouteille de chasselas et d’un verre, recouverts de toile et de poussière.
Classées monuments historiques depuis 1937, les guérites n’ont désormais d’autre usage que la signalisation du port. En attendant, qui sait, une nouvelle affectation?
Il était une fois, un 19 octobre...

Abonnez-vous !
Afin d'avoir accès à l'actualité de votre région au quotidien, souscrivez un abonnement au Journal de Morges. S'abonner, c'est soutenir une presse de qualité et indépendante.
 21
21