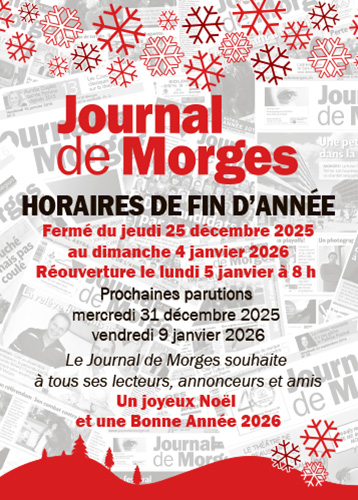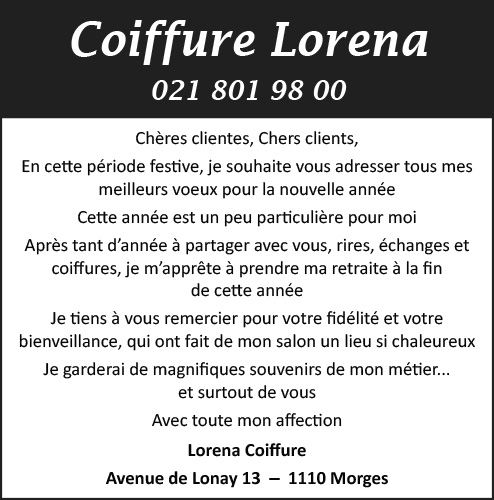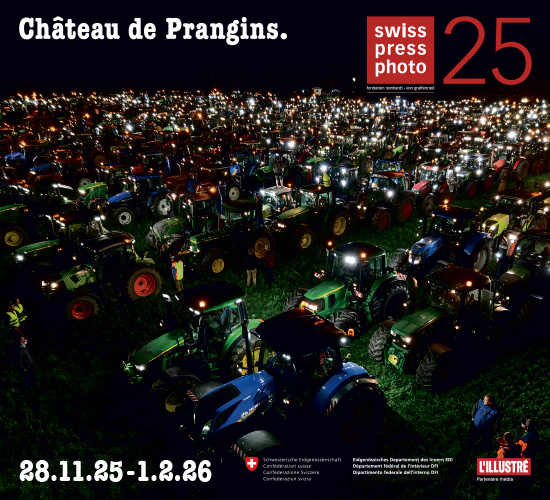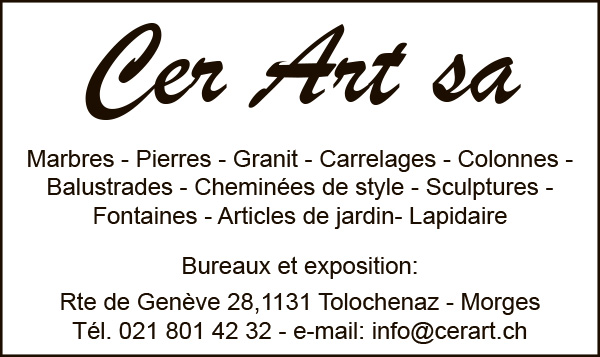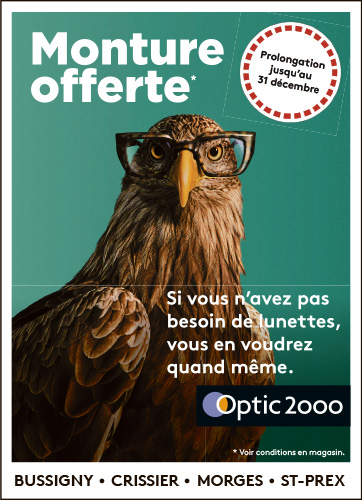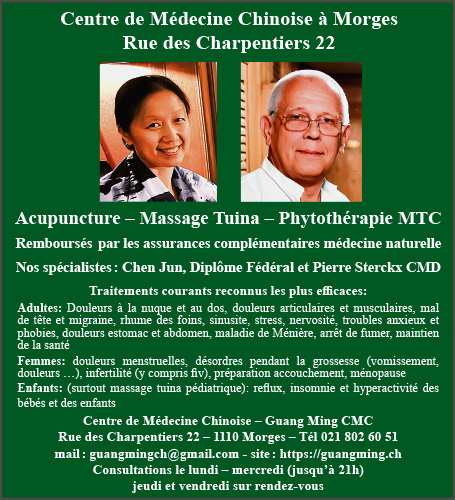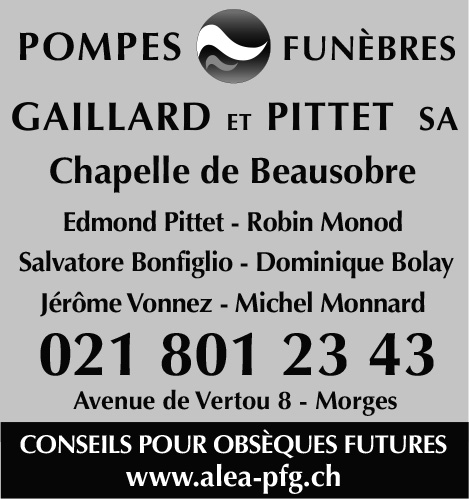La vie musicale de Lydia Opienska

Lydia Opienska-Barblan à son piano. Photo: Hermann
Un avis de désaffectation partielle du cimetière de Tolochenaz interroge sur la pérennité d’une figure morgienne. Portrait.
Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant Lydia Opienska-Barblan a été une célébrité morgienne durant de longues années. Musicienne, chanteuse, enseignante, directrice de chorale, elle est née et décédée à la Coquette. Et si son nom fait l’actualité, c’est à cause d’une publication officielle de la commune de Tolochenaz. «Cette parution concerne un avis de désaffectation partielle du cimetière où repose Madame Opienska-Barblan et dont la concession est touchée par cette mesure, a annoncé au Conseil l’élue morgienne Patricia Da Rocha. Il est important que sa mémoire soit honorée et nous ne pouvons rester immobiles face à ce projet de suppression de patrimoine.»
Pour mieux comprendre cette interpellation, il faut remonter le temps à la rencontre de Lydia Opienska-Barblan.
Une vie musicale
Cadette d’une famille de neuf enfants, Lydia Barblan naît à Morges le 12 avril 1890 dans un environnement largement musical. Son grand-père, pasteur et violoniste, pensait en effet qu’il fallait évangéliser en faisant apprécier la musique. Son fils, Jacob Barblan, le père de Lydia, était professeur d’allemand et, avec sa femme Marianne, ils furent tous deux d’excellents chanteurs amateurs.
Avec une fratrie pratiquant le chant, le piano, le violon, fondant et dirigeant des chœurs, il n’est pas étonnant qu’à huit ans déjà, Lydia réalisait sa première composition musicale pour piano, chant et violon qu’elle interprétât avec son frère et sa sœur. «Toute petite, la fillette désirait ardemment devenir une grande cantatrice et chanter avec tant d’émotion que le public en soit troublé», apprend-on dans sa biographie, signée Gilbert Bezençon.
La Morgienne grandit au 98 bis de la Grand-Rue dans une demeure dont les murs résonnaient longuement au son des concerts familiaux, chaque dimanche soir. Après sa scolarité, celle qui a aussi pris des leçons d’orgue part comme jeune fille au pair à Fribourg-en-Brisgau, où elle perfectionne encore sa pratique du chant et du piano.
Au conservatoire, Lydia Barblan apprend l’histoire de la musique, la théorie, l’harmonie et la composition. Elle profite également d’une activité musicale intense à Fribourg-en-Brisgau. «Bien que ne vivant pas dans l’abondance, elle économisait pour se cultiver musicalement. Cinq soirs sur sept, elle se rendait au concert ou à l’opéra», relate sa biographie. À seulement 21 ans, Lydia empoche son diplôme pour l’enseignement vocal. Dans les années 1910, elle deviendra professeur de chant au conservatoire de Fribourg-en-Brisgau puis à l’école de musique de la ville de Bâle. Parallèlement, la cantatrice donne des représentations entre la Suisse et l’Allemagne. En 1913, elle découvre la technique vocale qu’elle enseignera jusqu’à sa mort.
Retour morgien
Trois ans plus tard, lors de la Fête des musiciens suisses à Fribourg, Lydia Barblan rencontre celui qui deviendra son mari: Henryk Opienski, musicologue polonais dont la famille était installée depuis peu en Suisse, accueillie par Paderewski au début de la Première Guerre mondiale.
Avec Henryk, Lydia fonde «Motet et Madrigal», une formation de musiciens professionnels interprétant des compositions des maîtres de la Renaissance. Le groupe connaît un joli succès et se produit dans de nombreux pays d’Europe entre 1916 et 1942.
En 1924, Lydia et Henryk se marient et partent en Pologne. Pas longtemps puisque moins d’un an plus tard, Lydia Opienska-Barblan revient à Morges. Son frère Emmanuel, dont elle est restée très proche, doit subir une grave opération du larynx. Elle reprend alors du jour au lendemain toutes ses tâches, notamment la direction de chœurs, ce qui provoqua quelques remous dans certaines sociétés masculines, vite balayés par les bons résultats obtenus par la nouvelle directrice.
Son mari la rejoint et le couple s’installe à la Grand-Rue, dans la maison familiale des Barblan. Tout en poursuivant sa carrière de soliste et de professeur de chant, Lydia Opienska-Barblan s’investit également dans la vie locale. Elle reprend d’abord le chœur paroissial de Morges puis fonde les Mouettes qu’elle dirigera durant 30 ans. Elle prendra aussi la tête des ensembles de dames de Yens et de Gimel. «Avec ce dernier, en vingt ans de travail, elle n’entendit pas une seule réflexion désobligeante… Tous les critiques ne firent que des éloges sur la qualité vocale, l’excellente prononciation et le bon goût artistique de ces différents ensembles», relève Gilbert Bezençon dans sa biographie.
Décédée le 3 janvier 1983 à 92 ans, Lydia Opienska-Barblan est à ce jour l’unique femme à avoir reçu la bourgeoisie d’honneur de la ville de Morges. Une ville qui a décidé de perpétuer son souvenir (lire encadré).
Un monument dédié
Mercredi soir, lors du Conseil communal, la Municipalité a répondu à l’interpellation de Patricia Da Rocha par l’intermédiaire de Vincent Jaques. «À l’image d’Henryk Opienski qui a une allée à son nom dans le Parc de l’Indépendance, la Municipalité estime qu’il est juste que le souvenir de Lydia Opienska-Barblan perdure également. Elle propose donc de le maintenir par une œuvre rappelant son parcours musical et la création des Mouettes dans les Jardins de Seigneux.» Le membre de l’exécutif a ajouté que la concession des époux ne serait pas prolongée dans le cimetière de Tolochenaz. La sépulture est donc amenée à disparaître.
«Le chant, la direction, c’était sa vie»
Ancien élève de Lydia Opienska-Barblan et auteur de sa biographie, Gilbert Bezançon raconte.
S’il est un homme dont les souvenirs de la musicienne sont toujours intacts, c’est bien Gilbert Bezençon (photo). Compositeur, chef de chœur, professeur de musique, mais surtout élève et biographe de Lydia Opienska-Barblan, le Morgien se rappelle d’une femme exigeante. «Elle avait une manière très précise de faire travailler les paroles, explique-t-il. Elle nous faisait répéter les syllabes les unes après les autres, puis les mots, c’était un boulot fastidieux, mais essentiel, car si la voyelle donne le son, ce qui produit l’intelligence du texte, c’est la consonne. Donc Lydia les travaillait pour qu’elles explosent.»
Et si Lydia Opienska-Barblan était encore de ce monde? Que ferait-elle aujourd’hui? Pour Gilbert Bezençon, il n’y a pas beaucoup de doutes. «Elle serait toujours dans le chant. Les cours, la direction de chœurs, c’était sa vie, assure-t-il. Elle aurait cependant dû revoir sa technique vocale au vu des nouvelles informations que nous possédons dans la manière de poser sa voix.» Quant à savoir quel type d’ensemble elle dirigerait, le Morgien laisse planer une part de mystère. «Je pense quand même qu’elle serait restée dans l’art choral, mais c’est difficile à dire vu comme la société a changé. Mais je l’imagine plutôt dans la rigueur du classique, moins dans une interprétation des Beatles à quatre voix par exemple».
Pour l’ancien élève de Lydia Opienska-Barblan, il est essentiel pour Morges de maintenir la trace de ceux qui l’ont enrichie. «Au vingtième siècle, Morges a été un foyer culturel important, avec des artistes comme Paderewski, Soutter, mais aussi le couple Opienski/Opienska. Garder une empreinte de ce qu’ils ont fait est réellement précieux. Et il est vrai qu’en voyant leur sépulture aujourd’hui, presque à l’abandon, un autre moyen de se souvenir d’eux serait le bienvenu.» Un souhait qui a été entendu et partagé par les autorités morgiennes. Lydia Opienska-Barblan restera donc, non seulement dans les voix, mais aussi dans la mémoire collective d’une ville qui a fait partie de sa vie du début à la fin.
À lire également...

Favoriser la transition verte avec les impôts

Un génie morgien entre dans l’histoire

Quand Morges a (enfin) eu sa caserne

Abonnez-vous !
Afin d'avoir accès à l'actualité de votre région au quotidien, souscrivez un abonnement au Journal de Morges. S'abonner, c'est soutenir une presse de qualité et indépendante.
 1
1